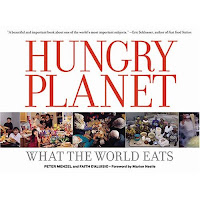 L’emploi ad nauseam d’expressions comme « mondialisation » ou « village global » nous ferait presque oublier qu’il existe toujours d’immenses disparités planétaires qui ne sont pas prêtes d’être comblées ! C’est ce que nous rappelle à sa manière le photographe Peter Menzel en braquant son objectif sur les pratiques alimentaires de nos contemporains aux quatre coins du monde. En tout, 30 familles visitées dans 24 pays différents. Le principe est simple : chaque famille est photographiée devant la nourriture qu’elle consomme en une semaine. La légende stipule la dépense que cela représente en dollars US. On mesure ainsi du premier coup d’œil à quel point les différences économiques sont aussi grandes que les différences culturelles. Mais aussi que l'humanité oscille décidement entre pénurie et malbouffe...
L’emploi ad nauseam d’expressions comme « mondialisation » ou « village global » nous ferait presque oublier qu’il existe toujours d’immenses disparités planétaires qui ne sont pas prêtes d’être comblées ! C’est ce que nous rappelle à sa manière le photographe Peter Menzel en braquant son objectif sur les pratiques alimentaires de nos contemporains aux quatre coins du monde. En tout, 30 familles visitées dans 24 pays différents. Le principe est simple : chaque famille est photographiée devant la nourriture qu’elle consomme en une semaine. La légende stipule la dépense que cela représente en dollars US. On mesure ainsi du premier coup d’œil à quel point les différences économiques sont aussi grandes que les différences culturelles. Mais aussi que l'humanité oscille décidement entre pénurie et malbouffe...Allemagne, Famille Melander de Bargteheide, 375.39 Euros ou 500.07 $ / semaine

Etats-Unis, Famille Revis de Caroline du nord, 341.98 $ / semaine
Grande-Bretagne, Famille Bainton de Cllingbourne Ducis, 155.54 £ ou 253.15 $ /semaine

Egypte, Famille Ahmed du Caire, 387.85 livres égyptiennes ou 68.53 $

Chine, Famille Cui du village Weitaiwu, 57,27 $ /semaine

Equateur, Famille Ayme de Tingo, 31.55 $ / semaine
Tchad, Famille Aboubakar, réfugiés du Darfour, 685 Francs CFA ou 1.23$ / semaine
D’autres clichés sont à découvrir sur le site de Peter Menzel ou du Time. Vous pouvez également télécharger ce powerpoint qui circule sur le net.





